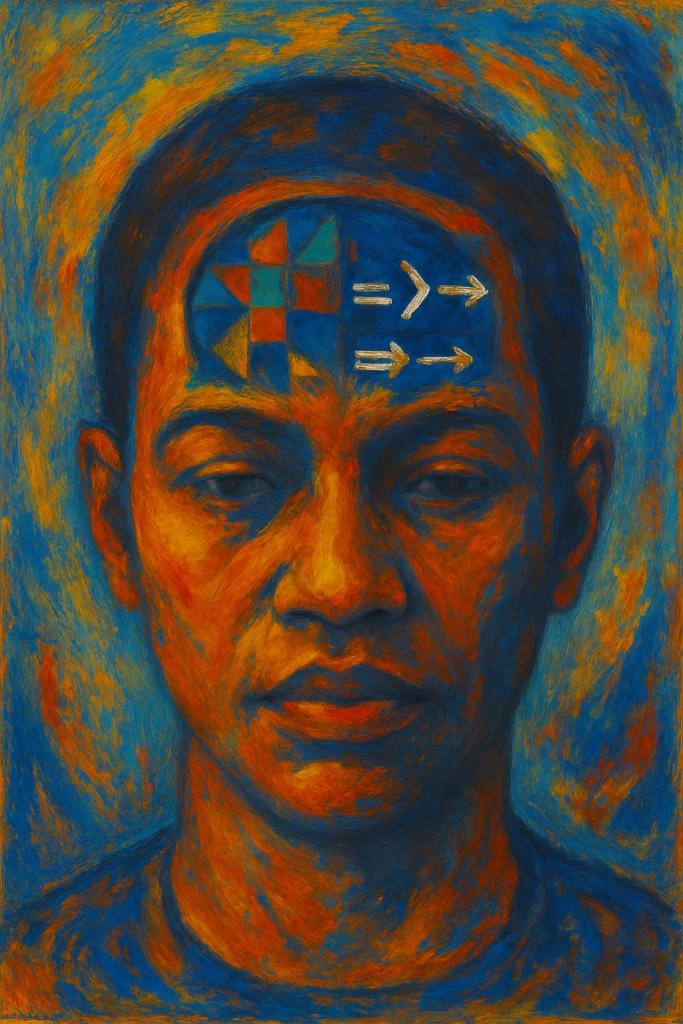Ce texte est la version écrite de mon intervention au webinaire inaugural de la Fondation Gabriel Péri, tenu le 26 mai 2025, sur le thème : « L’Afrique de l’Ouest émancipée du joug néocolonial ? Souveraineté en (re)construction » (lien ici). J’y propose une critique de la militarisation des relations franco-africaines et plaide pour une coopération solidaire, fondée sur les luttes populaires pour la dignité et l’émancipation.
Chers amis,
Je remercie Chystel Le Moing et la Fondation Gabriel Péri pour cette rencontre essentielle. Elle nous donne l’occasion d’effectuer un travail de mémoire critique et d’analyse stratégique sur les retraits militaires français d’Afrique de l’Ouest et du Tchad, mais aussi de penser les perspectives de paix et de souveraineté pour les peuples de cette région.
Je m’exprime ici au nom du Collectif Afrique du Parti communiste français. Dès 2013, nous avions émis de vives réserves sur l’intervention militaire française au Mali. Non par naïveté ou indifférence face aux périls djihadistes, mais parce que nous savions — et les faits nous ont donné raison — qu’aucune solution durable ne peut être apportée par des armées étrangères sans un réel projet politique de transformation sociale et démocratique. La militarisation du rapport à l’Afrique est une impasse.
Un retrait, fruit d’un désaveu populaire et d’un échec stratégique
Le retrait progressif des troupes françaises du Mali, du Burkina Faso, du Niger, puis du Sénégal et du Tchad, n’est pas survenu comme un coup de tonnerre dans un ciel serein. Il traduit un désaveu profond, fruit d’un long processus de désenchantement face à une présence militaire perçue comme une tutelle postcoloniale. Depuis Serval jusqu’à Barkhane, les interventions françaises, justifiées par la lutte contre le terrorisme, ont échoué à enrayer l’insécurité. Pire, elles ont accompagné l’enracinement des groupes armés, l’augmentation des violences et le déplacement de millions de civils. Sur le terrain, la France, loin d’être un rempart, est apparue comme un facteur d’instabilité.
Face à ce constat, les régimes sahéliens, souvent affaiblis, ont fini par s’aligner sur le rejet populaire croissant. C’est dans ce contexte que le Mali a rompu avec Paris en 2022, suivi du Burkina Faso, du Niger, puis du Sénégal et du Tchad. Le départ exigé des troupes françaises à Dakar, après plus d’un siècle de présence, marque un tournant symbolique. Il coïncide avec la dénonciation par Ndjamena de son accord de défense avec la France — un double camouflet pour Emmanuel Macron.
Ce basculement n’est pas spontané. Il s’inscrit dans la fin d’un cycle amorcé dès la chute du Mur de Berlin, où Paris, malgré son recul stratégique global, maintenait une emprise sur ses anciennes colonies à travers interventions militaires et diplomatie d’influence. Les opérations en Côte d’Ivoire, en Libye, au Mali et en Centrafrique, censées affirmer un rôle stabilisateur, ont plutôt nourri le ressentiment. Derrière l’illusion d’un « gendarme de l’Afrique » survivait un modèle néocolonial en agonie, dont les soubresauts ont précipité une rupture.
L’expulsion des forces françaises est ainsi devenue le signe d’une volonté d’autonomie renouvelée, portée par les peuples et assumée par certains dirigeants. Comme l’a exprimé le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye : « Pourquoi faudrait-il des soldats français au Sénégal ? Cela ne correspond pas à notre conception de la souveraineté. » Cette affirmation de dignité tranche avec l’attitude passée de Paris, notamment lors de la crise ivoirienne de 2010-2011. À l’époque, Nicolas Sarkozy, manipulant la résolution 1975 de l’ONU, avait légitimé l’intervention militaire contre Laurent Gbagbo pour installer Alassane Ouattara. Une opération brutale et cynique, qui a laissé des milliers de morts et une mémoire blessée — preuve s’il en fallait que la « Pax Gallica » fût tout sauf pacifique.
Une situation sécuritaire toujours critique mais complexe
La situation sécuritaire actuelle demeure préoccupante dans plusieurs pays du Sahel. Les groupes armés djihadistes — notamment le GSIM et l’EIGS — maintiennent leur pression sur les populations civiles. Les attaques se poursuivent dans le Liptako-Gourma, malgré les réorientations militaires opérées par les régimes en place. Le Centre du Mali reste en proie à une conflictualité multiforme, où se mêlent violences intercommunautaires, rivalités foncières et radicalisation religieuse. Au Burkina Faso, l’insécurité a entraîné la fermeture de milliers d’écoles et le déplacement de plus de deux millions de personnes. De larges territoire échappent à l’autorité de L’État. La menace djihadiste est une réalité palpable dans le nord du Bénin. Le Togo est aussi touché.
Mais il serait tout aussi erroné de dire que le retrait militaire français est la cause de cette insécurité. Le cœur du problème réside dans la fragilité structurelle des États sahéliens, minés par les inégalités, l’abandon des campagnes, l’effondrement des services publics, et l’absence de perspectives pour des jeunesses massivement sous-employées. Il y a là un terreau idéal pour toutes les formes de violence : djihadiste, communautaire ou mafieuse.
Par ailleurs, les défis du Sahel ne sont pas qu’un problème de sécurité. Ils sont aussi économiques, sociaux, climatiques. Ils impliquent un État fort, mais aussi légitime. Or les régimes actuels, qu’ils soient civils ou militaires, doivent impérativement restaurer leur légitimité auprès des citoyens. Cela suppose de répondre aux besoins réels : emploi, justice sociale, accès aux services publics, équité territoriale. C’est par le politique que viendra la sécurité, et non l’inverse.
Une Afrique en rupture : vers des souverainetés actives
Depuis les indépendances, la France a structuré sa présence en Afrique autour de trois piliers : les bases militaires, le franc CFA, et l’encadrement des élites politiques. Ce système, que Jean-Pierre Dozon appelait « l’État franco-africain », est aujourd’hui en ruine. Il n’est plus viable politiquement, ni moralement, ni stratégiquement.
La France est concurrencée. Une nouvelle ère s’ouvre : celle des partenariats multipolaires. La Russie, la Chine, la Turquie, les pays du Golfe ou encore le Brésil viennent proposer d’autres modèles — avec leurs propres limites, mais dans une logique de rééquilibrage. Ces nouvelles alliances sont une chance à condition qu’elles soient interrogées politiquement, démocratiquement, dans l’intérêt des peuples.
Le rejet de l’influence française s’inscrit dans un contexte plus large de transformations profondes. L’Afrique d’aujourd’hui, forte de sa jeunesse, regorge d’une énergie nouvelle portée par des aspirations panafricaines, souverainistes et progressistes. Au Sénégal, cette révolution générationnelle s’incarne dans le leadership de Bassirou Diomaye Faye et d’Ousmane Sonko. Sous la bannière de PASTEF, ils incarnent cette volonté de rompre avec les mécanismes de dépendance postcoloniale et de repenser une souveraineté active, inclusive, démocratique.
Conclusion : pour une solidarité internationaliste et populaire
L’échec de l’option militariste au Sahel est patent. Mais le retrait des troupes françaises ne doit pas être lu comme une fin en soi, mais comme une opportunité : celle de reconstruire un autre rapport à l’Afrique, fondé non sur les bases militaires, mais sur les solidarités et la coopération. Non sur les injonctions sécuritaires, mais sur la justice sociale.
Notre tâche, en tant que communistes et internationalistes, est de soutenir les forces sociales africaines qui luttent pour la paix, la sécurité humaine, la souveraineté et la dignité. Et de faire en sorte que la France ne soit plus une puissance tutélaire, mais un allié des peuples.
Je vous remercie.