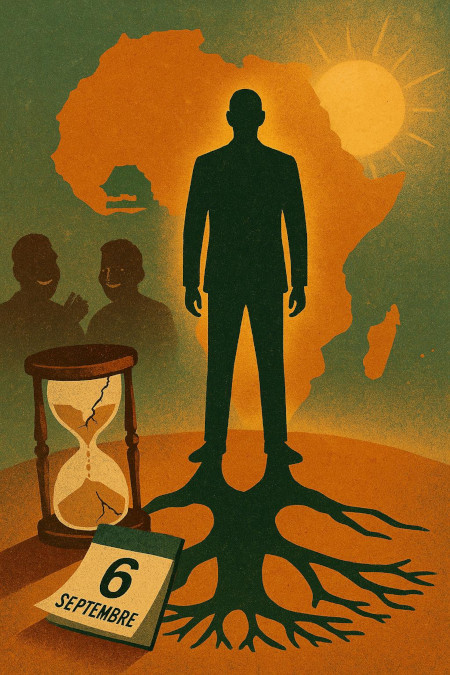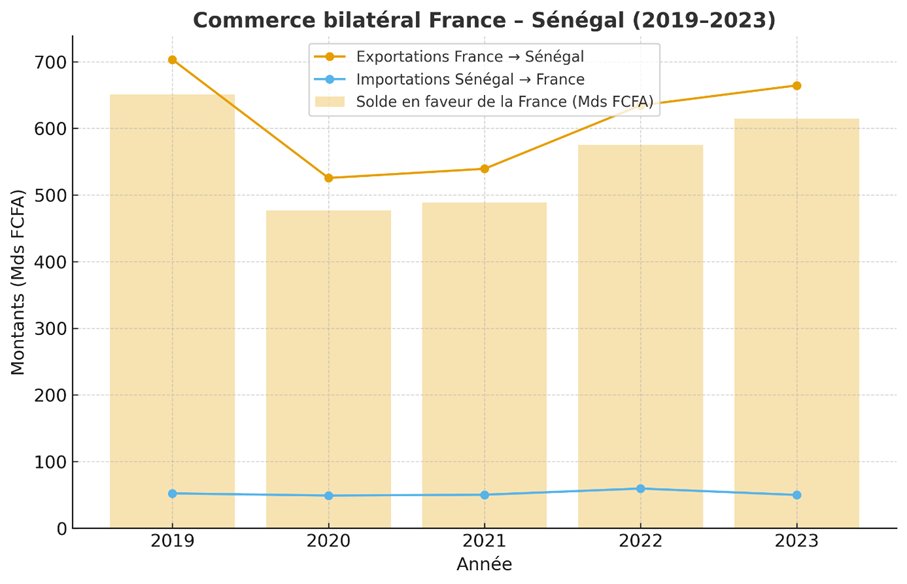Inspiré d’une note de recherche que j’ai réalisée pour le Groupe de travail Afrique du PGE, cet article revient sur l’Éthiopie et son destin politique et économique.
Le 9 septembre 2025, l’Éthiopie a inauguré le Grand barrage de la Renaissance (GERD) sur le Nil Bleu, au terme de quatorze années de travaux. Ce n’est pas seulement l’inauguration d’un ouvrage hydroélectrique de 5 150 mégawatts (MW), le plus puissant d’Afrique. C’est la célébration éclatante d’un choix politique : celui d’un volontarisme souverainiste, qui a refusé l’injonction du statu quo et la dépendance aux financements extérieurs pour affirmer la maîtrise nationale sur une ressource vitale. À cette occasion, le Premier ministre Abiy Ahmed a salué une victoire historique de l’unité et de la dignité éthiopiennes, rappelant que ce barrage est l’œuvre du peuple, bâti grâce à son effort et à sa ténacité.
Un projet de souveraineté face aux résistances
Lorsque l’ancien Premier ministre Meles Zenawi (1955-2012) lança le projet en 2011, rares étaient ceux qui croyaient l’Éthiopie capable de mobiliser seule les fonds nécessaires. La Banque mondiale et de nombreux bailleurs se sont dérobés, au nom d’un prétendu « risque régional ». Qu’à cela ne tienne : l’État éthiopien organisa une collecte nationale, mobilisa sa diaspora, imposa des contributions aux fonctionnaires. En somme, il fit de ce barrage une entreprise collective, financée par l’effort du peuple. Ce fut un acte de souveraineté, un pied de nez à ceux qui pensaient que l’Afrique devait rester sous perfusion financière internationale.
Les résistances furent nombreuses : pressions diplomatiques de l’Égypte, crispations du Soudan, menaces voilées d’intervention. Le Nil Bleu, dont les eaux jaillissent du lac Tana en Éthiopie, est depuis des siècles un objet de rivalités. Les autorités du Caire brandissaient des « droits historiques », mais Addis-Abeba a répliqué par le langage de la dignité : l’Éthiopie n’accepterait pas d’être dépossédée de ses « droits naturels » sur son propre territoire.
Le volontarisme au cœur du développement
Ce projet n’est pas une exception isolée : il s’inscrit dans une trajectoire politique plus large. Depuis le Growth and Transformation Plan lancé au début des années 2010, l’Éthiopie a multiplié les grands chantiers : routes, voies ferrées, parcs industriels, universités, infrastructures électriques. Ces choix relèvent d’un véritable « étatisme développementaliste », inspiré de la Chine, qui mise sur la planification et la mobilisation interne plutôt que sur le marché livré à lui-même.
Ce volontarisme s’est nourri d’une contrainte : celle d’un géant démographique de plus de 120 millions d’habitants, dont la jeunesse appelle des réponses rapides en matière d’énergie, d’emplois, d’urbanisation. Le GERD est donc la pièce maîtresse d’un pari : transformer une croissance démographique en dividende économique, grâce à l’électricité bon marché et à l’intégration régionale par l’exportation d’énergie.
Un colosse énergétique aux promesses multiples
Le Grand barrage de la Renaissance impressionne par ses dimensions titanesques. Haut de 145 mètres et long de près de 1,8 km, il retient un réservoir d’une capacité de 74 milliards de mètres cubes, soit presque l’équivalent du volume du lac Léman multiplié par cent. Avec ses 6 450 mégawatts installés, il devient la plus grande centrale hydroélectrique d’Afrique et l’une des vingt premières au monde.
Les avantages attendus sont considérables : d’abord, offrir l’électricité à des millions d’Éthiopiens qui en étaient privés jusque-là, réduisant ainsi la dépendance aux énergies fossiles et au bois de feu. Ensuite, exporter l’énergie excédentaire vers le Soudan, Djibouti ou le Kenya, ce qui renforcera l’intégration économique régionale et générera des devises précieuses. Enfin, stabiliser l’approvisionnement énergétique des villes et des industries, condition indispensable à l’industrialisation et à la création d’emplois. Pour un pays dont la majorité de la population reste rurale et jeune, cet accès à l’électricité constitue une promesse de transformation radicale.
Le symbole d’une renaissance africaine
Aujourd’hui, alors que les turbines du barrage s’apprêtent à alimenter non seulement l’Éthiopie, mais aussi les pays voisins, le GERD incarne quelque chose de plus grand qu’un équipement énergétique. Il est le symbole d’une nation qui se projette au-delà de ses divisions internes, dans un contexte pourtant marqué par des guerres civiles et des tensions régionales. C’est l’un des rares projets qui suscitent un consensus national, réconciliant temporairement un pays fracturé.
L’inauguration du barrage de la Renaissance n’est donc pas seulement un moment éthiopien : c’est une leçon adressée à tout le continent. Elle rappelle que la souveraineté se conquiert, qu’elle s’exerce par des actes concrets, et que l’Afrique ne peut se contenter d’être un « musée pour touristes », selon la formule ironique de Meles Zenawi.
À l’heure où les défis énergétiques, démographiques et climatiques frappent de plein fouet nos pays, l’exemple éthiopien montre que le volontarisme politique, lorsqu’il s’appuie sur le peuple et assume les conflits qu’il suscite, peut transformer le destin d’une nation. Le GERD est plus qu’un barrage : il est la preuve que la Renaissance africaine peut être une réalité, à condition d’oser la souveraineté.