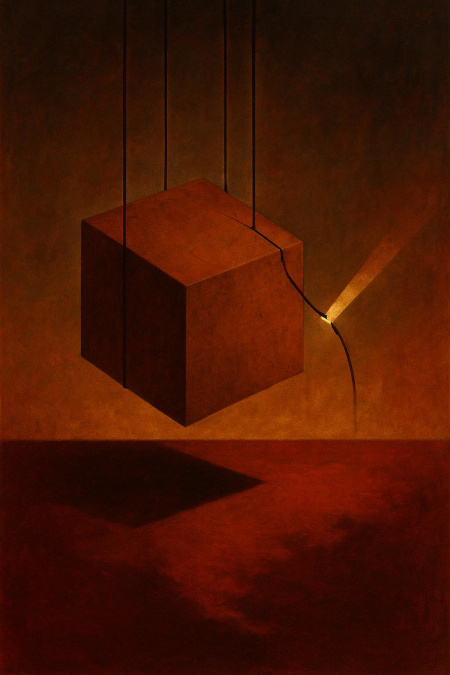Face au FMI, le Premier ministre Ousmane Sonko assume un refus clair : dire non à la restructuration de la dette, c’est refuser de répéter les échecs d’hier et affirmer que la souveraineté commence là où s’arrête l’obéissance financière.
Il est des moments où un pays doit cesser de parler à voix basse. Le refus réitéré par le Premier ministre Ousmane Sonko d’une restructuration de la dette publique sénégalaise n’est ni une posture d’orgueil ni une fuite en avant. C’est un acte politique assumé, un choix de souveraineté, et une rupture avec une longue tradition d’obéissance financière qui a trop souvent confondu prudence et résignation.
La dette héritée est réelle, massive, validée par les institutions nationales et internationales. Elle est donc un fait politique total. Mais ce fait n’impose ni le fatalisme ni la capitulation.
Rompre avec le fatalisme de la « solution unique »
Depuis quarante ans, l’Afrique est sommée de croire qu’il n’existe qu’une seule grammaire économique : celle de l’ajustement, de la compression et de la discipline imposée de l’extérieur. Refuser aujourd’hui une restructuration de la dette, ce n’est pas nier la gravité de la situation — dette proche de 119 % du PIB, déficit budgétaire élevé —, c’est refuser l’illusion selon laquelle la même ordonnance produirait soudain des effets différents.
Le cœur de la position gouvernementale est là : le Sénégal a continué à honorer sa dette, à la refinancer sur le marché régional, sans programme FMI, pendant plus d’un an. Cette réalité, souvent passée sous silence, montre que la dette est lourde, mais viable si l’État reprend la main sur ses priorités, ses choix budgétaires et ses temporalités. Le Plan de redressement économique et social (PRES) engagé — rationalisation des dépenses, mobilisation accrue des recettes, arbitrages clairs — n’est pas une promesse abstraite : il génère déjà des ressources additionnelles appelées à croître à partir de 2027.
C’est précisément à ce niveau que se situe la cohérence de la position défendue par le Premier ministre Ousmane Sonko. En refusant un ajustement dicté de l’extérieur, il ne s’écarte pas de la rationalité économique ; il s’inscrit au contraire dans les enseignements que les institutions internationales elles-mêmes ont fini par formuler après des décennies d’échecs. Dans un article programmatique publié par le FMI en 2003, Éviter un nouveau piège de la dette[1], Christina Daseking et Julie Kozack reconnaissaient que les crises de la dette des pays à faible revenu des années 1980-1990 étaient le produit d’endettements fondés sur des projections de croissance irréalistes, des chocs exogènes répétés et des appareils productifs fragiles. Plus encore, elles admettaient que l’endettement était devenu un facteur freinant l’investissement et la croissance. Leur conclusion était sans ambiguïté : même les emprunts concessionnels doivent être contractés avec une extrême prudence, sous peine de replonger les pays dans un cycle d’ajustements destructeurs. Autrement dit, l’histoire économique récente — telle que reconnue par le FMI lui-même — montre que la restructuration répétée de la dette, assortie de conditionnalités orthodoxes, prépare souvent la crise suivante plutôt qu’elle ne la résout.
La responsabilité des institutions et la mémoire des ajustements
Soutenir le Premier ministre, c’est aussi refuser l’amnésie organisée. Les institutions de Bretton Woods ne peuvent prétendre avoir découvert la situation sénégalaise par surprise. Audits, « staff visits » et soutiens budgétaires massifs accordés au régime de Macky Sall attestent d’une connaissance au moins partielle — parfois complaisante — des déséquilibres accumulés.
L’histoire économique contemporaine africaine est éloquente : chaque restructuration accompagnée d’ajustements a produit la même séquence — affaiblissement de l’État, démantèlement de l’appareil productif, montée de l’informel, socialisation des pertes et privatisation des gains. Des entreprises industrielles publiques aux politiques d’investissement, les sociétés africaines ont payé le prix fort de ces cures d’austérité. Revenir à ce modèle serait moins une solution qu’une répétition.
Un combat sénégalais, un enjeu africain
Le choix du Sénégal dépasse ses frontières. Ce qui est en jeu, c’est le droit pour un État africain de certifier ses comptes, d’assumer la vérité, puis de décider souverainement de sa trajectoire de redressement. Ce droit, s’il est reconnu à Dakar, le sera demain à Cotonou, Abidjan ou Yaoundé.
La solidarité africaine ne peut être à géométrie variable : on applaudit ensemble les victoires sportives, mais l’on se tait quand un pays affronte un système qui, depuis des décennies, organise l’endettement sans développement. Soutenir la position de Sonko, c’est affirmer que la discipline budgétaire n’a de sens que si elle sert l’investissement productif, la santé, l’éducation et les infrastructures — bref, la vie quotidienne des peuples.
Dire non, pour dire oui à autre chose
Dire non au réajustement imposé, ce n’est pas dire non au monde. C’est dire oui à un autre rapport au monde : coopération choisie, partenariats diversifiés, financement endogène renforcé, intégration régionale assumée. C’est rappeler que les grandes nations ne se sont pas construites en s’interdisant toute marge de manœuvre budgétaire et monétaire, mais en l’utilisant pour bâtir des capacités productives durables.
En ce sens, la fermeté d’Ousmane Sonko n’est ni un pari solitaire ni un geste improvisé. Elle est un signal adressé au peuple sénégalais — premier partenaire de l’effort — et au continent africain : la souveraineté n’est pas un slogan, c’est une pratique. Et parfois, cette pratique commence par un mot simple, mais lourd de sens : non.
[1] Daseking, C., & Kozack, J. (2003). Éviter un nouveau piège de la dette. Finances & Développement, FMI, décembre 2003.